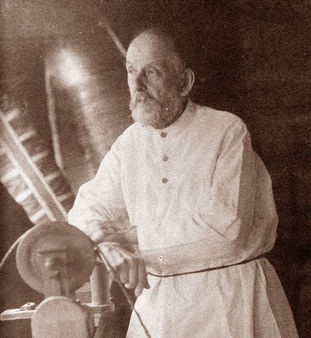|
 La vie est généralement considérée comme un processus continu. Il survient au moment de l'émergence d'un être vivant dans un œuf, une spore ou une graine, passe par un certain nombre d'étapes de développement plus ou moins complexes, atteint une certaine floraison, diminue avec le vieillissement et se termine au moment de la vieillesse, lorsque tous les processus vitaux s'arrêtent. La vie est généralement considérée comme un processus continu. Il survient au moment de l'émergence d'un être vivant dans un œuf, une spore ou une graine, passe par un certain nombre d'étapes de développement plus ou moins complexes, atteint une certaine floraison, diminue avec le vieillissement et se termine au moment de la vieillesse, lorsque tous les processus vitaux s'arrêtent.
Nous connaissons cependant le phénomène d'oppression de la vie, lorsque la vie s'arrête temporairement dans le corps et que les processus vitaux sont plus ou moins supprimés. De tels phénomènes comprennent le sommeil, normal et pathologique (hypnose), l'anesthésie (lorsque le corps est exposé au chloroforme, l'éther, etc.) et enfin l'hibernation, qui est connue chez de nombreux animaux. Dans tous ces cas, cependant, il n'y a pas de suspension complète des processus vitaux - les mouvements s'arrêtent, la sensibilité est considérablement affaiblie et disparaît presque, mais les processus métaboliques sont préservés, l'animal n'arrête pas de respirer, ses organes sont toujours alimentés en sang, les intestins continuent à digérer les aliments. En état d'hibernation, tous ces processus ralentissent considérablement, mais ils ne s'arrêtent toujours pas complètement.
Nous connaissons également le phénomène de la vie cachée des graines, des spores et des œufs d'animaux. Une graine est un objet immobile, apparemment mort, la vie ne se manifeste pas en elle, mais cela vaut la peine de la mettre dans certaines conditions d'humidité et de température, et de violents processus de vie se réveillent en elle. Cependant, même à l'état dormant, dans des conditions normales de stockage, certains processus vitaux très faibles ou, du moins, certains changements chimiques, se produisent apparemment à l'intérieur des graines. Par conséquent, les graines ne peuvent pas durer éternellement.
Les œufs d'animaux sont moins résistants, même dans les cas où ils sont spécialement adaptés pour le stockage à long terme, par exemple dans les daphnies. La durée de vie en pot maximale pendant le stockage est encore de deux à trois décennies. Il est clair qu'ici dans les œufs, comme dans les graines, se produisent des processus faibles qui changent un être vivant.
Mais si les processus de la vie peuvent être tellement supprimés et réduits qu'ils deviennent complètement invisibles, est-il possible de les arrêter pendant un certain temps à l'aide d'influences extérieures? Est-il possible d'interrompre la vie pour qu'elle revienne ensuite?
 Dès 1701, une découverte a été faite qui semblait donner une réponse affirmative à cette question. Le célèbre microscopiste amateur néerlandais Anton Leeuwenhoek a examiné le sable qu'il a collecté dans la gouttière du toit de sa maison de Delft à l'aide de son propre microscope primitif, mais déjà assez bien agrandi. Pour cela, il a mis une petite quantité de sable parfaitement sec dans un tube de verre rempli d'eau. En l'examinant au microscope, il a remarqué l'apparition dans l'eau de minuscules «insectes» qui nageaient rapidement à l'aide de «roues», c'est-à-dire des couronnes de cils sur la tête. Dès 1701, une découverte a été faite qui semblait donner une réponse affirmative à cette question. Le célèbre microscopiste amateur néerlandais Anton Leeuwenhoek a examiné le sable qu'il a collecté dans la gouttière du toit de sa maison de Delft à l'aide de son propre microscope primitif, mais déjà assez bien agrandi. Pour cela, il a mis une petite quantité de sable parfaitement sec dans un tube de verre rempli d'eau. En l'examinant au microscope, il a remarqué l'apparition dans l'eau de minuscules «insectes» qui nageaient rapidement à l'aide de «roues», c'est-à-dire des couronnes de cils sur la tête.
Ce phénomène l'intéressait, d'autant plus que, par des expériences, il a établi que les «insectes» sont prélevés sur du sable sec et non sur de l'eau, et d'autres expériences ont montré qu'ils peuvent à nouveau être séchés avec le sable - ils rétrécissent et se transforment en minuscules morceaux indiscernables. à partir de grains de sable. Sous une forme sèche, avec du sable, Levenguk a gardé ces animaux, appelés plus tard rotifères, d'abord pendant plusieurs semaines, puis pendant plusieurs mois, voire plus d'un an, et de temps en temps les ranimés en les plaçant dans l'eau. Ils sont venus à la vie assez rapidement et ont nagé vivement, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que l'eau se soit tarie. Il rapporta cette remarquable découverte dans une lettre à la Royal Society of London, dans le procès-verbal duquel elle fut publiée plus tard, mais apparemment peu d'attention lui fut accordée à ce moment-là.
Ce n'est que plus tard, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, que ces expériences de «résurrection miraculeuse d'entre les morts» de rotifères séchés ont suscité l'intérêt des scientifiques. À peu près à la même époque, un autre scientifique célèbre, Spallanzani, professeur de physique et d'histoire naturelle à l'Université de Pavie, a étudié ce phénomène en détail, faisant de nombreuses expériences et observations. Il a découvert que les rotifères peuvent sécher et se régénérer jusqu'à onze fois de suite, que la présence de sable est importante pour leur renaissance réussie, ce qui rend le séchage plus progressif, et qu'une fois séchés, ils peuvent tolérer des températures aussi élevées (54-56 ° C) auxquelles, étant dans l'eau, ils meurent.
En outre, il a découvert un autre groupe de créatures qui ont exactement les mêmes capacités de séchage et de revitalisation que les rotifères - il s'agissait de petites créatures microscopiques, semblables à des chenilles, vivant dans la mousse poussant sur le toit. Pour leurs mouvements lents, il les appelait tardigrades, et ce nom leur est resté jusqu'à ce jour.
Plus tard, il s'est avéré qu'un autre groupe d'habitants de mousses et de lichens se comportait exactement de la même manière - ce sont de petits vers ronds d'un nématode. Tous ces animaux sont spécialement adaptés au dessèchement, tout comme la mousse ou le lichen dans lequel ils vivent sont adaptés à cela. Sous les rayons brûlants du soleil et sous l'action d'un vent sec, ils se dessèchent, se rétractent, se transforment en légers grains de poussière emportés par le vent. Aussitôt que; cependant, la rosée ou la pluie humidifient la mousse, elles gonflent, se redressent et prennent vie.
Il est intéressant de noter que déjà à cette époque, à la découverte même du phénomène de la renaissance d'animaux apparemment morts, deux points de vue opposés s'étaient établis sur son essence. Levenguk pensait que les rotifères ne se dessèchent pas complètement, car leurs coquilles sont si denses qu'elles ne permettent pas à l'eau de s'évaporer complètement. Par conséquent, leur vie ne se termine pas complètement, mais seulement s'affaiblit, puis s'embrase à nouveau et ils reprennent vie. En revanche, Spallanzani pensait qu'une fois desséchée, la vie cessait en fait, puis les animaux étaient ressuscités. Il reconnut donc une véritable cessation de la vie, une interruption complète de celle-ci.
Plus tard, au XIXe siècle, ces deux visions diamétralement opposées du renouveau ont continué à exister simultanément dans la science. Certains chercheurs ont cependant tenté de nier le phénomène même du renouveau, et parmi eux, le célèbre microscopiste et chercheur allemand cilié Ehrenberg s'est prononcé avec une insistance particulière contre le renouveau. Il a fait valoir que les rotifères dans le sable à l'état séché non seulement se nourrissent, mais aussi se reproduisent, pondent des œufs, et que leur renaissance dépend simplement du fait qu'ils ont acquis l'habitude de vivre avec plus ou moins d'humidité.
 Des études expérimentales extrêmement minutieuses des biologistes français Dwyer, Davain et Gavarre, dont les résultats ont été vérifiés et confirmés par une commission spéciale de la Société de Biologie de Paris, présidée par le célèbre Brock (1860), ont convaincu le monde scientifique de la validité des observations de Levenguk et Spallanzani. La commission de Brock s'est prononcée en faveur de la possibilité d'un séchage complet et d'un arrêt complet de la vie. «À l'heure actuelle, dit Broca, il y a deux enseignements: l'un reconnaît le réveil comme un phénomène vital, l'autre comme un phénomène indépendant de la vie, conditionné exclusivement par l'aspect matériel d'un être vivant. Le premier enseignement est «en totale contradiction avec les résultats des expériences de séchage, le second, au contraire, non seulement ne les contredit pas, mais permet même d'expliquer l'expérience de base du séchage et toutes les autres expériences». Des études expérimentales extrêmement minutieuses des biologistes français Dwyer, Davain et Gavarre, dont les résultats ont été vérifiés et confirmés par une commission spéciale de la Société de Biologie de Paris, présidée par le célèbre Brock (1860), ont convaincu le monde scientifique de la validité des observations de Levenguk et Spallanzani. La commission de Brock s'est prononcée en faveur de la possibilité d'un séchage complet et d'un arrêt complet de la vie. «À l'heure actuelle, dit Broca, il y a deux enseignements: l'un reconnaît le réveil comme un phénomène vital, l'autre comme un phénomène indépendant de la vie, conditionné exclusivement par l'aspect matériel d'un être vivant. Le premier enseignement est «en totale contradiction avec les résultats des expériences de séchage, le second, au contraire, non seulement ne les contredit pas, mais permet même d'expliquer l'expérience de base du séchage et toutes les autres expériences».
Des scientifiques aussi éminents que Claude Bernard, Wilhelm Preyer et plus tard - Max Vervorn se sont joints à l'opinion sur la possibilité d'interrompre temporairement la vie. Preyer, en 1873, proposa un terme spécial pour tout le phénomène du renouveau - anabiose (du grec ava - vers le haut et - vie, - «réveil», «résurrection»), qui devint alors fermement établi dans la science.Jusqu'à récemment, la plupart des chercheurs impliqués dans la mise en place d'expériences sur l'animation suspendue (ils se tenaient cependant du point de vue opposé - ils ne parvenaient pas à créer de telles conditions dans lesquelles la cessation de la vie serait évidente et, néanmoins, un renouveau se produirait. Par conséquent, la conviction a été créée. que la vie ne s'arrête pas complètement en se desséchant, que chez les animaux séchés qui n'ont pas perdu toute l'eau qu'ils contiennent, certains processus de vie étouffés, même très faibles, se poursuivent, il y a une durée de vie minimale (vita minima). n'est pas tombé dans une telle erreur qu'Ehrenberg, et n'a pas affirmé que les rotifères séchés se nourrissent et se reproduisent, mais la présence d'un certain métabolisme en eux, sous la forme de processus moteurs au moins lents, pourrait être supposée, car ils ont des résidus d'eau dans les environs. l'atmosphère contient de l'oxygène.
Pour prouver la possibilité d'arrêter la vie, il fallait priver les animaux séchés de toute l'eau libre contenue en eux, non liée chimiquement, et arrêter de respirer. La commission de Brock a également établi que la mousse avec des animaux séchés peut être chauffée au point d'ébullition de l'eau pendant une demi-heure et, néanmoins, les rotifères prennent vie. Un tel séchage intense est cependant associé à un risque pour la vie des animaux séchés. Les auteurs de ces lignes ont subi une expérience de séchage plus minutieuse en 1920. La mousse avec des rotifères séchée à l'air sur du chlorure de calcium a été placée dans un tube à essai, qui, en outre, contenait un morceau de sodium métallique pour absorber l'oxygène et l'humidité résiduels. De ce tube à essai, l'air a été évacué avec une pompe à mercure jusqu'à ce qu'un vide avec une pression de 0,2 mm soit obtenu, et le tube a ensuite été scellé. Après y avoir stocké la mousse pendant plusieurs mois, les rotifères, qui ont été progressivement transférés dans l'eau, ont repris vie, malgré un si long séjour sous vide sans oxygène et avec une sécheresse totale.
Le scientifique autrichien Dr. G. Ram a réussi à livrer en 1920-22. une série d'expériences encore plus convaincantes et efficaces.
Tout d'abord, il a mis en place une expérience de stockage de mousse sous vide, assez similaire au mien (mais sans utilisation de sodium), et avec exactement les mêmes résultats.
Puis il a transféré son travail au célèbre laboratoire des basses températures prof. Kammerling Onnes à Leiden (Hollande), où il était possible d'utiliser n'importe quel gaz à l'état liquide. Là, il a mis en place une expérience de séchage de la mousse avec des rotifères et des tardigrades dans des gaz inactifs. La mousse a été placée dans un tube rempli d'hydrogène ou d'hélium absolument sec obtenu à partir de gaz liquéfié. Ensuite, ce gaz a été pompé par une pompe à mercure jusqu'au vide le plus complet possible, puis il a été réintroduit et pompé à nouveau. Après trois de ces manipulations, le tube a été scellé et stocké plus ou moins longtemps. Après l'avoir ouvert, les animaux ont repris vie dans l'eau.
 Pour un séchage encore plus complet, Ram a construit un appareil. La mousse était placée dans une boule de verre, dans laquelle ce gaz provenait d'un récipient contenant de l'hydrogène liquide, et sur son chemin il passait à travers une bobine placée dans l'air liquide; grâce au refroidissement, les derniers restes de l'humidité extraite de la mousse s'y sont déposés. Le tube était connecté à une pompe à mercure, qui donnait le vide maximum. Une ampoule était connectée au même tube qu'un appareil de contrôle pour surveiller le vide. De l'autre côté (à droite), la bille communiquait avec plusieurs éprouvettes, dans lesquelles la mousse pouvait être versée à la fin de l'expérience. Pour éliminer l'air adsorbé de ces tubes à essai, comme s'ils adhéraient à leurs parois, ils ont été chauffés à 300 ° C dans un four électrique pendant l'expérience. Comme dans l'expérience précédente, de l'hydrogène a été injecté dans la bille et pompé plusieurs fois. Cependant, une particularité de cette expérience était que le ballon était chauffé à 70 ° C pour un séchage plus parfait.Cette température est celle établie par le contrôle! expériences, n'a pas d'effet nocif sur les animaux séchés. Après cette procédure de séchage, la mousse a été versée dans des tubes à essai refroidis en inclinant le tube et en les scellant. Ces tubes ont été stockés et ouverts à des moments différents, de un à huit mois. Les animaux qu'ils contenaient prenaient vie. Pour un séchage encore plus complet, Ram a construit un appareil. La mousse était placée dans une boule de verre, dans laquelle ce gaz provenait d'un récipient contenant de l'hydrogène liquide, et sur son chemin il passait à travers une bobine placée dans l'air liquide; grâce au refroidissement, les derniers restes de l'humidité extraite de la mousse s'y sont déposés. Le tube était connecté à une pompe à mercure, qui donnait le vide maximum. Une ampoule était connectée au même tube qu'un appareil de contrôle pour surveiller le vide. De l'autre côté (à droite), la bille communiquait avec plusieurs éprouvettes, dans lesquelles la mousse pouvait être versée à la fin de l'expérience. Pour éliminer l'air adsorbé de ces tubes à essai, comme s'ils adhéraient à leurs parois, ils ont été chauffés à 300 ° C dans un four électrique pendant l'expérience. Comme dans l'expérience précédente, de l'hydrogène a été injecté dans la bille et pompé plusieurs fois. Cependant, une particularité de cette expérience était que le ballon était chauffé à 70 ° C pour un séchage plus parfait.Cette température est celle établie par le contrôle! expériences, n'a pas d'effet nocif sur les animaux séchés. Après cette procédure de séchage, la mousse a été versée dans des tubes à essai refroidis en inclinant le tube et en les scellant. Ces tubes ont été stockés et ouverts à des moments différents, de un à huit mois. Les animaux qu'ils contenaient prenaient vie.
Enfin, en plus du séchage, Ram a exposé les animaux à des températures extrêmement basses, à savoir de -269 ° à -272,8 ° C, soit une température qui n'est que 0,2 ° C plus élevée que le zéro absolu (-273 ° C), soit c'est-à-dire la température minimale théoriquement possible. Dans tous ces cas, le résultat est le même: après une décongélation minutieuse et progressive, les animaux séchés se relancent après avoir été transférés dans l'eau.
Que nous disent ces expériences de Rama? Le séchage des animaux avec des gaz absolument secs (hydrogène, hélium) qui ne supportent pas la respiration et pénètrent facilement dans les coquilles, lorsqu'ils sont pompés à un vide complet et un peu plus de chauffage, bien sûr, devrait éliminer toute l'eau libre du corps. Il est peu probable que l'eau adsorbée reste dans ces conditions. En l'absence totale d'oxygène et d'eau, il est difficile d'imaginer que des processus respiratoires puissent avoir lieu - tout échange de gaz dans le corps doit s'arrêter. Mais, si dans ce cas il est encore possible de parler de certains processus métaboliques anaérobies (c'est-à-dire se produisant sans présence d'air) ou intramoléculaires qui sont possibles dans le corps, alors lors de l'utilisation de basses températures proches du kul absolu, non quels processus métaboliques sont hors de question. En effet, dans ces conditions, à la température de l'hélium liquide, aucune réaction chimique n'est possible du tout, et d'autant moins, bien sûr, des réactions aussi subtiles que celles se produisant dans le corps sont possibles - elles nécessitent la participation de l'eau, des colloïdes, des gaz, des sels, des enzymes, nécessitent une forte mobilité des produits chimiques. particules. Dans des conditions proches du zéro absolu, toutes les molécules chimiques perdent leur mobilité. Non seulement tous les liquides, mais aussi les gaz passent à l'état solide, les colloïdes et, en général, tous les composés contenant au moins de l'eau liée chimiquement deviennent solides comme une pierre. Le corps d'un rotifère séché dans ces conditions ne diffère guère beaucoup dans son activité chimique d'un grain de quartz.
Ainsi, nous devons admettre que dans les conditions de ces expériences, les habitants séchés des mousses ont complètement perdu toutes, même les plus petites, manifestations des processus de la vie. Quel genre de vie est possible dans un morceau de pierre solide? Et si ensuite, après la décongélation et l'ajout d'eau, la vie leur est revenue, cela signifie tout d'abord que, mais dans ka la vie est possible, la vie peut être interrompue - ce n'est pas toujours un processus continu.
Comprenant les raisons de ce phénomène, on voit que la possibilité du retour de la vie à un organisme privé d'eau et, de plus, soumis à l'action de températures extrêmement basses, n'est concevable que si tous ces effets destructeurs ne détruisent pas la matière vivante, ne produisent pas en elle de tels changements que serait, comme le disent les chimistes, irréversible. En effet, si nous séchons de l'acide silicique gélatineux - une substance inorganique, qui est la même solution colloïdale que la plupart des parties constitutives d'un organisme vivant, nous verrons qu'il peut être séché jusqu'à une certaine limite de sorte qu'il ne fera qu'épaissir, mais ne changera pas. Il est nécessaire d'y ajouter à nouveau de l'eau et elle se transformera à nouveau en gelée liquide. Si, cependant, cette limite est franchie, la gelée deviendra dure, opaque et aucune quantité d'eau ne pourra la ramener à son état antérieur - l'acide silicique a subi des changements irréversibles dus à un séchage excessif. La même chose se produit avec un être vivant.
Les recherches menées au cours des 10 à 15 dernières années ont montré que de nombreux animaux peuvent être soumis à un séchage très sévère.Ainsi, en séchant les vers de terre, il est possible d'en extraire, d'après mes expériences et celles de Hull, environ 3/8 de toute l'eau qu'ils contiennent.
Les sangsues de tortues japonaises qui rampent à terre et se prélassent au soleil pendant une longue période peuvent se dessécher au point de perdre 80% de leur poids.
J'ai réussi à sécher les jeunes grenouilles et crapauds au point de perdre la moitié de toute l'eau contenue dans le corps. Prof. BD Morozov a séché divers organes et tissus d'animaux jusqu'à la perte de 1/4, 1/2 ou même 3/4 d'eau, et ils n'ont pas perdu leur vitalité. Dans tous ces cas, le séchage n'est possible que jusqu'à une certaine limite, suivi de changements irréversibles de la matière vivante et de la mort.
Chez les habitants des mousses et des lichens, cette capacité de séchage est poussée à l'extrême. À travers une longue évolution, il s'est développé en eux comme une adaptation à leur vie quotidienne. Leur habitat est périodiquement soumis à un fort séchage sous les rayons ardents du soleil, puis à un mouillage par la pluie, la rosée ou le brouillard. S'il n'avait pas la capacité de se dessécher, leur mort serait inévitable. Et maintenant, les colloïdes vivants de leur corps ont acquis la capacité d'abandonner librement toute l'eau qu'ils contiennent, sans subir de changements irréversibles qui mettraient leur vie en danger. Dans des conditions naturelles, il est vrai, leur séchage n'est jamais complet, mais dans des conditions expérimentales, évidemment, il peut être amené à la perte de toute l'eau libre. En l'absence d'eau, les basses températures, proches du zéro absolu, s'avèrent inoffensives.
Nous avons donc ici l'un des cas les plus remarquables d'adaptation à l'environnement extérieur, une adaptation qui n'affecte pas dans le développement d'organes ou de traits de forme, mais dans un changement de toute la structure de la matière vivante, dans l'acquisition de capacités tout à fait extraordinaires par cette dernière.
Ce cas est-il unique en son genre? Pas du tout. Nous devons nous rappeler uniquement les cas de vie cachée répandus dans le règne végétal et animal, dont nous avons parlé plus haut. En effet, même là, dans les graines et les kystes des animaux, se produit la même adaptation de la matière vivante au dessèchement et à un séjour prolongé à l'état sec.
 Et si dans des conditions naturelles les graines et les spores ne sont pas absolument sèches et contiennent toujours plusieurs pour cent d'eau, alors, il faut penser, c'est cette circonstance qui provoque en elles ces processus métaboliques lents et faiblement exprimés, qui entraînent finalement un affaiblissement et une disparition. viabilité des semences. Jusqu'à récemment, la théorie de la «vie minimale» dominait également dans la science concernant les semences et les disputes. On a supposé que la vie en eux ne s'arrêtait pas, mais se résumait uniquement aux manifestations les plus minimales des échanges gazeux et des processus de métabolisme qui leur étaient associés. Les expériences de Becquerel sur les graines et de McFadane sur les spores de micro-organismes ont montré qu'ici, dans les conditions expérimentales, un arrêt complet de la vie est possible - une interruption de la vie est possible. Et si dans des conditions naturelles les graines et les spores ne sont pas absolument sèches et contiennent toujours plusieurs pour cent d'eau, alors, il faut penser, c'est cette circonstance qui provoque en elles ces processus métaboliques lents et faiblement exprimés, qui entraînent finalement un affaiblissement et une disparition. viabilité des semences. Jusqu'à récemment, la théorie de la «vie minimale» dominait également dans la science concernant les semences et les disputes. On a supposé que la vie en eux ne s'arrêtait pas, mais se résumait uniquement aux manifestations les plus minimales des échanges gazeux et des processus de métabolisme qui leur étaient associés. Les expériences de Becquerel sur les graines et de McFadane sur les spores de micro-organismes ont montré qu'ici, dans les conditions expérimentales, un arrêt complet de la vie est possible - une interruption de la vie est possible.
Becquerel a soumis les graines de diverses plantes à un séchage artificiel sous vide lorsqu'elles sont chauffées à 40 ° C, les a maintenues sous vide pendant 4 mois puis les a placées pendant 10 heures dans de l'hélium liquide, ce qui a donné une température de - 269 ° C.Lors de la germination de ces graines, il a été constaté qu'elles germent encore mieux que le témoin, stocké in vivo - donc les graines de trèfle ont toutes germé, alors que seulement 90% du témoin ont germé.
Des expériences similaires ont été menées par Becquerel sur les spores de fougères et de mousses et par McFadane sur les spores de diverses bactéries et cocci; dans tous ces cas, un séchage vigoureux sous vide et des températures proches de zéro arrêtaient tous les processus vitaux, rendaient inconcevables les manifestations des réactions métaboliques même les plus réduites pendant des heures et des jours. Néanmoins, après l'élimination de ces affections retardatrices, la vie est revenue au corps et est revenue à elle-même.
Becquerel dit à juste titre que dans les conditions de ces expériences, le protoplasme devient plus dur que le granit et, bien qu'il ne perde pas sa nature colloïdale, il perd l'état nécessaire à l'assimilation et à la dissimilation. Si la cellule est privée d'eau et de bassins, passés à l'état solide, si ses enzymes sont séchées et que le protoplasme a cessé d'être à l'état de solution colloïdale, il est clair que dans ce cas on peut difficilement parler de «ralentissement de la vie». La vie sans eau, sans air, sans particules colloïdales en suspension dans un milieu liquide est impossible - dans ces conditions particulières, il était possible de réaliser une véritable «vie cachée» au sens de Claude Bernard, c'est-à-dire l'arrêt complet de la vie.
Ainsi, arrêter la vie, interrompre le processus de la vie dans certaines conditions est possible.
P. Yu. Schmidt
|
 La vie est généralement considérée comme un processus continu. Il survient au moment de l'émergence d'un être vivant dans un œuf, une spore ou une graine, passe par un certain nombre d'étapes de développement plus ou moins complexes, atteint une certaine floraison, diminue avec le vieillissement et se termine au moment de la vieillesse, lorsque tous les processus vitaux s'arrêtent.
La vie est généralement considérée comme un processus continu. Il survient au moment de l'émergence d'un être vivant dans un œuf, une spore ou une graine, passe par un certain nombre d'étapes de développement plus ou moins complexes, atteint une certaine floraison, diminue avec le vieillissement et se termine au moment de la vieillesse, lorsque tous les processus vitaux s'arrêtent. Dès 1701, une découverte a été faite qui semblait donner une réponse affirmative à cette question. Le célèbre microscopiste amateur néerlandais Anton Leeuwenhoek a examiné le sable qu'il a collecté dans la gouttière du toit de sa maison de Delft à l'aide de son propre microscope primitif, mais déjà assez bien agrandi. Pour cela, il a mis une petite quantité de sable parfaitement sec dans un tube de verre rempli d'eau. En l'examinant au microscope, il a remarqué l'apparition dans l'eau de minuscules «insectes» qui nageaient rapidement à l'aide de «roues», c'est-à-dire des couronnes de cils sur la tête.
Dès 1701, une découverte a été faite qui semblait donner une réponse affirmative à cette question. Le célèbre microscopiste amateur néerlandais Anton Leeuwenhoek a examiné le sable qu'il a collecté dans la gouttière du toit de sa maison de Delft à l'aide de son propre microscope primitif, mais déjà assez bien agrandi. Pour cela, il a mis une petite quantité de sable parfaitement sec dans un tube de verre rempli d'eau. En l'examinant au microscope, il a remarqué l'apparition dans l'eau de minuscules «insectes» qui nageaient rapidement à l'aide de «roues», c'est-à-dire des couronnes de cils sur la tête. Des études expérimentales extrêmement minutieuses des biologistes français Dwyer, Davain et Gavarre, dont les résultats ont été vérifiés et confirmés par une commission spéciale de la Société de Biologie de Paris, présidée par le célèbre Brock (1860), ont convaincu le monde scientifique de la validité des observations de Levenguk et Spallanzani. La commission de Brock s'est prononcée en faveur de la possibilité d'un séchage complet et d'un arrêt complet de la vie. «À l'heure actuelle, dit Broca, il y a deux enseignements: l'un reconnaît le réveil comme un phénomène vital, l'autre comme un phénomène indépendant de la vie, conditionné exclusivement par l'aspect matériel d'un être vivant. Le premier enseignement est «en totale contradiction avec les résultats des expériences de séchage, le second, au contraire, non seulement ne les contredit pas, mais permet même d'expliquer l'expérience de base du séchage et toutes les autres expériences».
Des études expérimentales extrêmement minutieuses des biologistes français Dwyer, Davain et Gavarre, dont les résultats ont été vérifiés et confirmés par une commission spéciale de la Société de Biologie de Paris, présidée par le célèbre Brock (1860), ont convaincu le monde scientifique de la validité des observations de Levenguk et Spallanzani. La commission de Brock s'est prononcée en faveur de la possibilité d'un séchage complet et d'un arrêt complet de la vie. «À l'heure actuelle, dit Broca, il y a deux enseignements: l'un reconnaît le réveil comme un phénomène vital, l'autre comme un phénomène indépendant de la vie, conditionné exclusivement par l'aspect matériel d'un être vivant. Le premier enseignement est «en totale contradiction avec les résultats des expériences de séchage, le second, au contraire, non seulement ne les contredit pas, mais permet même d'expliquer l'expérience de base du séchage et toutes les autres expériences». Pour un séchage encore plus complet, Ram a construit un appareil. La mousse était placée dans une boule de verre, dans laquelle ce gaz provenait d'un récipient contenant de l'hydrogène liquide, et sur son chemin il passait à travers une bobine placée dans l'air liquide; grâce au refroidissement, les derniers restes de l'humidité extraite de la mousse s'y sont déposés. Le tube était connecté à une pompe à mercure, qui donnait le vide maximum. Une ampoule était connectée au même tube qu'un appareil de contrôle pour surveiller le vide. De l'autre côté (à droite), la bille communiquait avec plusieurs éprouvettes, dans lesquelles la mousse pouvait être versée à la fin de l'expérience. Pour éliminer l'air adsorbé de ces tubes à essai, comme s'ils adhéraient à leurs parois, ils ont été chauffés à 300 ° C dans un four électrique pendant l'expérience. Comme dans l'expérience précédente, de l'hydrogène a été injecté dans la bille et pompé plusieurs fois. Cependant, une particularité de cette expérience était que le ballon était chauffé à 70 ° C pour un séchage plus parfait.Cette température est celle établie par le contrôle! expériences, n'a pas d'effet nocif sur les animaux séchés. Après cette procédure de séchage, la mousse a été versée dans des tubes à essai refroidis en inclinant le tube et en les scellant. Ces tubes ont été stockés et ouverts à des moments différents, de un à huit mois. Les animaux qu'ils contenaient prenaient vie.
Pour un séchage encore plus complet, Ram a construit un appareil. La mousse était placée dans une boule de verre, dans laquelle ce gaz provenait d'un récipient contenant de l'hydrogène liquide, et sur son chemin il passait à travers une bobine placée dans l'air liquide; grâce au refroidissement, les derniers restes de l'humidité extraite de la mousse s'y sont déposés. Le tube était connecté à une pompe à mercure, qui donnait le vide maximum. Une ampoule était connectée au même tube qu'un appareil de contrôle pour surveiller le vide. De l'autre côté (à droite), la bille communiquait avec plusieurs éprouvettes, dans lesquelles la mousse pouvait être versée à la fin de l'expérience. Pour éliminer l'air adsorbé de ces tubes à essai, comme s'ils adhéraient à leurs parois, ils ont été chauffés à 300 ° C dans un four électrique pendant l'expérience. Comme dans l'expérience précédente, de l'hydrogène a été injecté dans la bille et pompé plusieurs fois. Cependant, une particularité de cette expérience était que le ballon était chauffé à 70 ° C pour un séchage plus parfait.Cette température est celle établie par le contrôle! expériences, n'a pas d'effet nocif sur les animaux séchés. Après cette procédure de séchage, la mousse a été versée dans des tubes à essai refroidis en inclinant le tube et en les scellant. Ces tubes ont été stockés et ouverts à des moments différents, de un à huit mois. Les animaux qu'ils contenaient prenaient vie. Et si dans des conditions naturelles les graines et les spores ne sont pas absolument sèches et contiennent toujours plusieurs pour cent d'eau, alors, il faut penser, c'est cette circonstance qui provoque en elles ces processus métaboliques lents et faiblement exprimés, qui entraînent finalement un affaiblissement et une disparition. viabilité des semences. Jusqu'à récemment, la théorie de la «vie minimale» dominait également dans la science concernant les semences et les disputes. On a supposé que la vie en eux ne s'arrêtait pas, mais se résumait uniquement aux manifestations les plus minimales des échanges gazeux et des processus de métabolisme qui leur étaient associés. Les expériences de Becquerel sur les graines et de McFadane sur les spores de micro-organismes ont montré qu'ici, dans les conditions expérimentales, un arrêt complet de la vie est possible - une interruption de la vie est possible.
Et si dans des conditions naturelles les graines et les spores ne sont pas absolument sèches et contiennent toujours plusieurs pour cent d'eau, alors, il faut penser, c'est cette circonstance qui provoque en elles ces processus métaboliques lents et faiblement exprimés, qui entraînent finalement un affaiblissement et une disparition. viabilité des semences. Jusqu'à récemment, la théorie de la «vie minimale» dominait également dans la science concernant les semences et les disputes. On a supposé que la vie en eux ne s'arrêtait pas, mais se résumait uniquement aux manifestations les plus minimales des échanges gazeux et des processus de métabolisme qui leur étaient associés. Les expériences de Becquerel sur les graines et de McFadane sur les spores de micro-organismes ont montré qu'ici, dans les conditions expérimentales, un arrêt complet de la vie est possible - une interruption de la vie est possible.